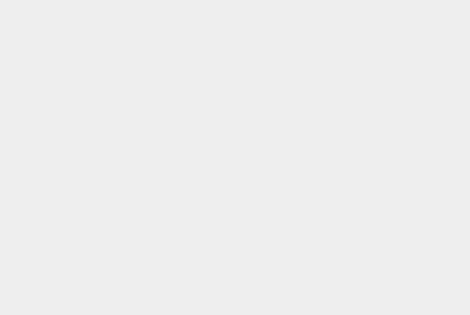Ingrédient clé du béton, le ciment est à lui seul responsable d'environ 8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Avec une urbanisation galopante et environ 30 milliards de tonnes de béton coulées chaque année, la pression pour trouver des alternatives durables est immense. Alors que les discussions sur le climat se concentrent souvent sur l'énergie, les transports et l'agriculture, le secteur de la construction reste un géant endormi. Toutefois, des recherches innovantes menées en Allemagne commencent à changer la donne.
Dans un institut de recherche de Dresde, des scientifiques mettent au point un matériau de construction révolutionnaire dérivé des cyanobactéries, communément appelées algues bleues. Ces anciens micro-organismes, qui existent depuis plus de deux milliards d'années, sont capables de photosynthèse, au cours de laquelle ils absorbent du CO₂ et produisent de l'oxygène. En imitant le processus naturel par lequel les cyanobactéries forment des croûtes calcaires appelées stromatolites, les chercheurs sont parvenus à créer un matériau qui non seulement évite les émissions de CO₂, mais capture activement le carbone de l'atmosphère.
Cette approche biogénique réimagine la construction à partir de la base. Au lieu de cuire le calcaire à plus de 1 400 degrés Celsius pour produire du ciment, un processus qui émet de grandes quantités de CO₂, ces bactéries peuvent travailler à température ambiante dans des moules perméables à la lumière, en se liant à des matériaux ajoutés tels que le sable, les fibres de chanvre ou même des débris de construction. En réalisant la photosynthèse, les bactéries initient la minéralisation, déposant du carbonate de calcium qui constitue l'ossature structurelle du matériau.
Bien que le produit obtenu ne soit pas aussi dense ou porteur que le béton traditionnel, son potentiel pour les éléments non structurels est prometteur. Les applications pourraient inclure des panneaux d'isolation, des matériaux de façade ou des briques intérieures pour les zones où le poids et la résistance à la compression sont moins critiques. Les essais en cours portent sur diverses combinaisons de substrats, dans le but d'équilibrer l'impact sur l'environnement et la durabilité.
Cependant, malgré les promesses scientifiques, la mise à l'échelle industrielle reste incertaine. La recherche actuelle est largement financée par des bourses universitaires, et les phases suivantes, qui nécessitent une analyse détaillée du cycle de vie et une production pilote, n'ont pas encore reçu un soutien financier suffisant. C'est là que la stratégie de financement de l'Europe révèle un point aveugle critique.
Des milliards de subventions européennes et nationales sont alloués chaque année à des projets de construction et de décarbonisation. Cependant, une grande partie de ce financement favorise les technologies établies ou les modèles de retour sur investissement à court terme. Les innovations à haut risque et à fort impact, comme le béton bactérien, n'en sont encore qu'à leurs débuts et peinent à obtenir le soutien nécessaire pour passer du laboratoire au marché. Dans des pays comme le Portugal, par exemple, le soutien a tendance à favoriser les matériaux biologiques traditionnels comme le bois, tandis que les biotechnologies véritablement perturbatrices restent à l'écart.
En outre, l'énergie nécessaire à la culture des cyanobactéries, en particulier l'éclairage et le contrôle de la température, soulève des inquiétudes légitimes. Sans une intégration adéquate dans les systèmes d'énergie renouvelable, l'empreinte carbone de la culture des micro-organismes pourrait annuler certains des gains environnementaux. Les chercheurs sont conscients de ces compromis et recherchent activement des moyens d'optimiser la culture et l'utilisation de l'énergie.
Dans ce contexte, des pays comme le Portugal sont particulièrement bien placés pour prendre les devants. Avec un ensoleillement abondant, un vaste accès au littoral et des investissements croissants dans l'énergie solaire et marine, le Portugal dispose de tous les ingrédients naturels pour alimenter durablement de tels processus biotechnologiques. Au lieu de dépendre des combustibles fossiles ou d'importer de l'énergie, la production locale utilisant des énergies renouvelables pourrait rendre les matériaux à base de cyanobactéries non seulement viables, mais aussi exemplaires en matière de fabrication responsable sur le plan climatique.
Ce qu'il faut maintenant, c'est un effort coordonné pour repenser les subventions à la construction et le soutien à la recherche. Au-delà du piégeage du carbone et de la réduction des émissions, ces matériaux pourraient redéfinir notre conception des déchets et transformer les gravats de démolition ou même le sable du désert en nouveaux éléments de construction régénératifs. Si elles ont la possibilité de s'étendre, ces innovations pourraient devenir une pièce essentielle du puzzle climatique.
Le travail réalisé à Dresde prouve que la construction durable et économe en ressources n'est pas un rêve lointain. Elle prend déjà forme, mais discrètement, dans des boîtes de Petri et des moules d'essai, n'attendant que l'occasion de construire l'avenir.
Paulo Lopes is a multi-talent Portuguese citizen who made his Master of Economics in Switzerland and studied law at Lusófona in Lisbon - CEO of Casaiberia in Lisbon and Algarve.